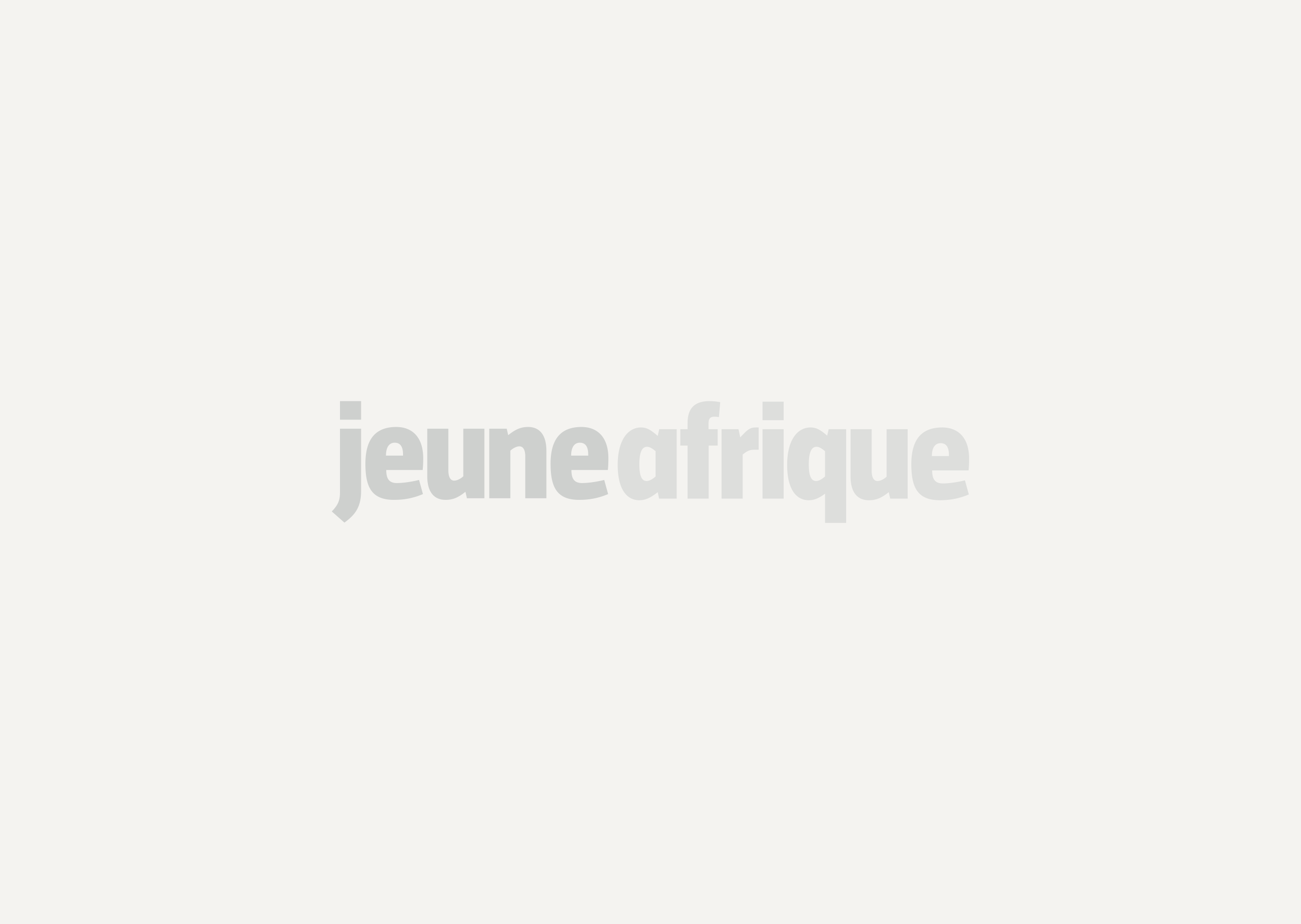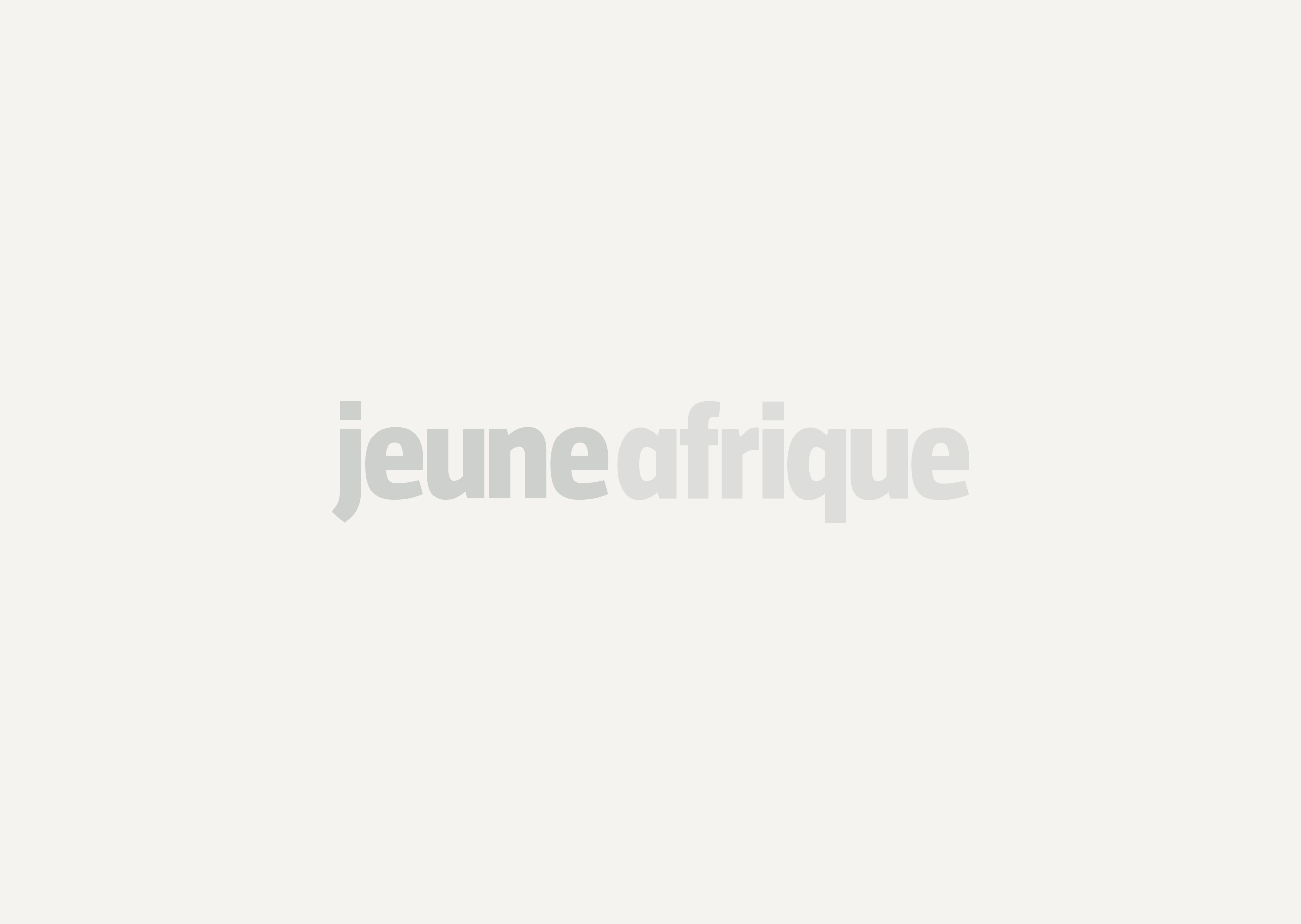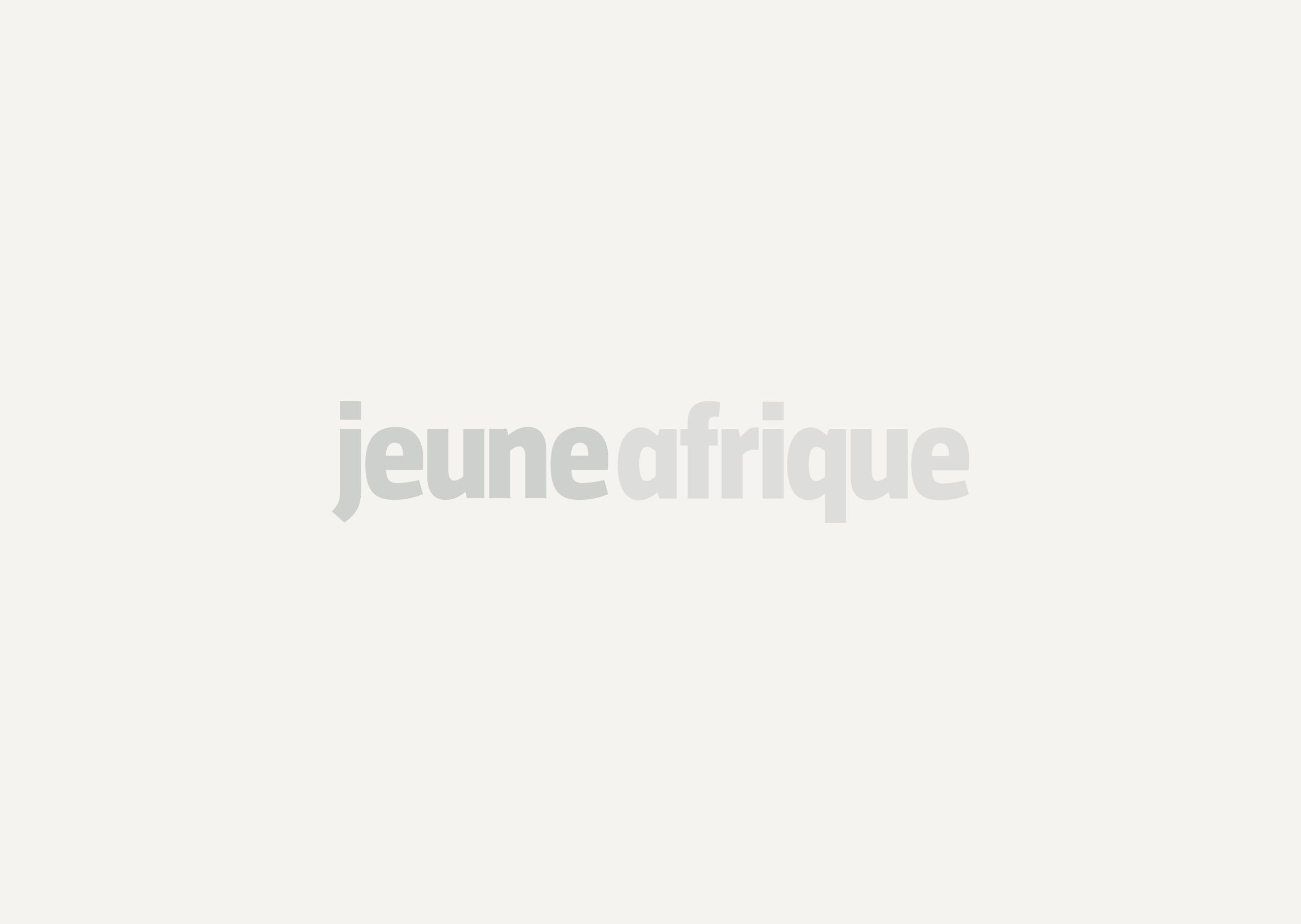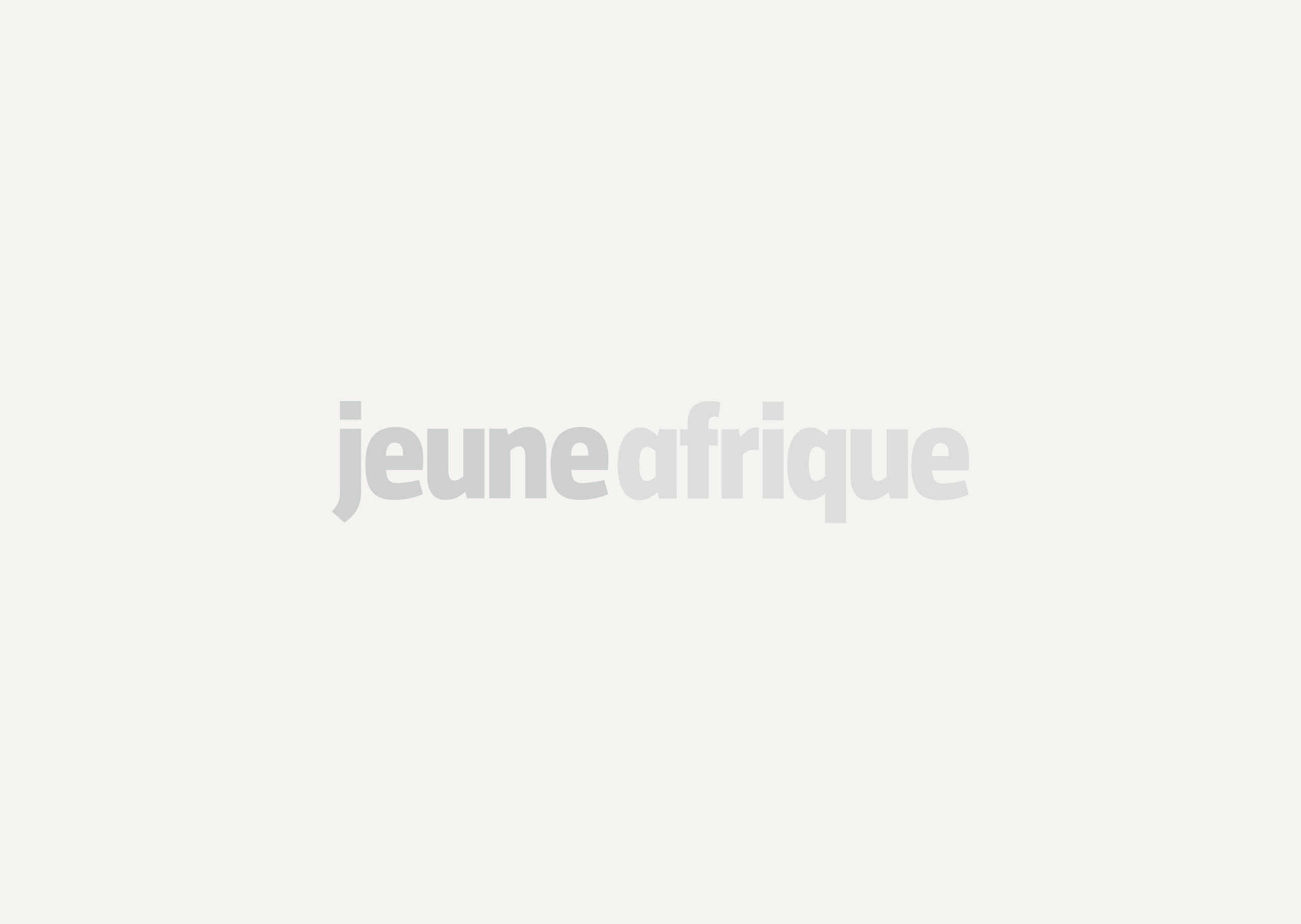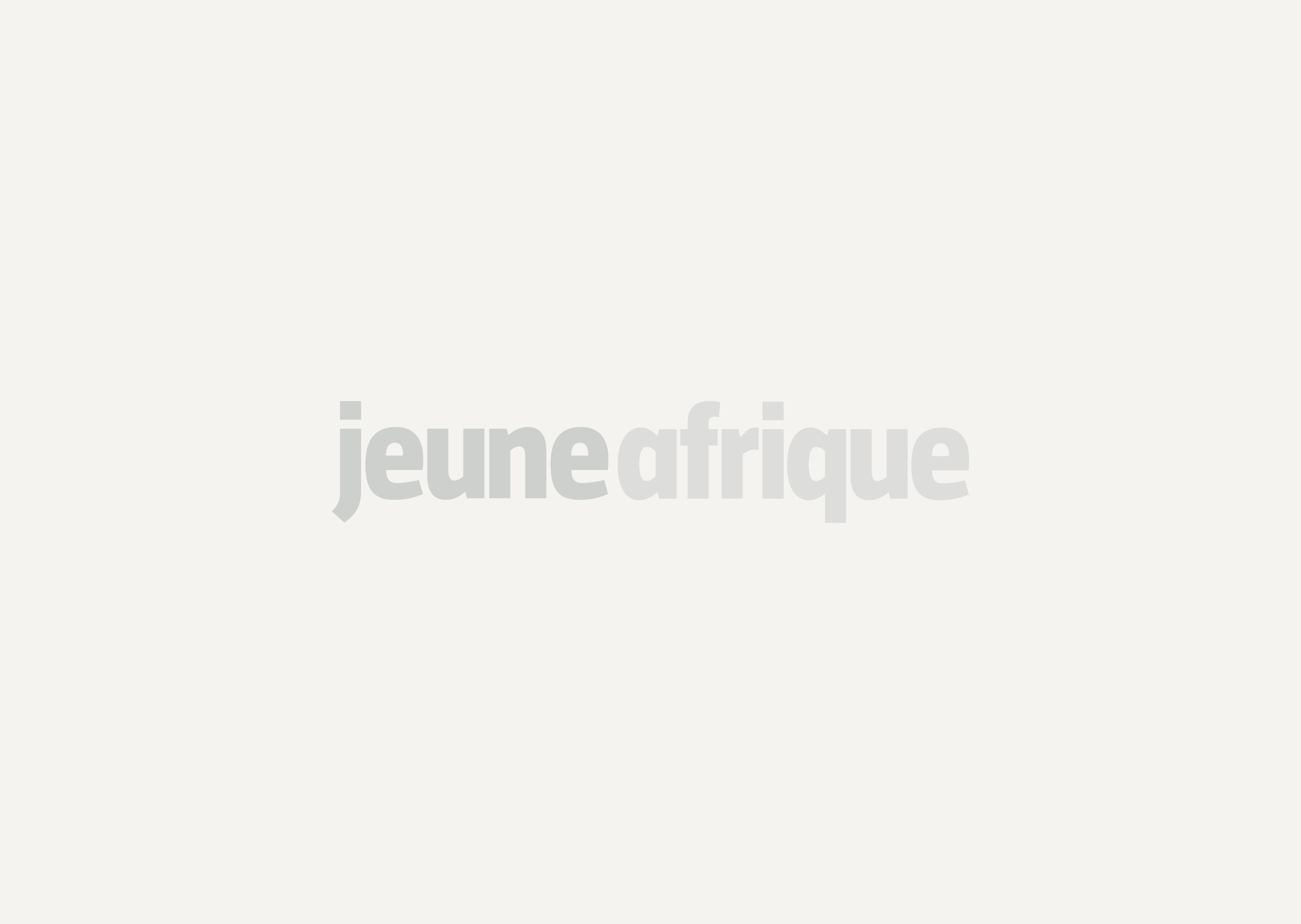À l'ouverture du second round de négociations inter-maliennes, le 1er septembre 2014, à Alger. © Farouk Batiche / AFP
À l'ouverture du second round de négociations inter-maliennes, le 1er septembre 2014, à Alger. © Farouk Batiche / AFP
Le gouvernement malien et la coordination des groupes armés du nord se sont séparés en bons termes, le 27 novembre dernier à Alger, avec un projet d’accord de paix qui pourrait être signé à la mi-janvier après d'ultimes retouches. Jeune Afrique vous donne les grandes lignes de ce texte porteur d'espoir.
Issu des négociations menées à Alger, un "Projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali" a été présenté par le gouvernement malien le 2 décembre à Bamako. Articulé en neuf titres et 73 articles, ce document de 21 pages, dont Jeune Afrique a obtenu copie (voir ci-dessous), est une synthèse réalisée par le médiateur algérien des propositions faites par les deux parties.
Pour Bamako, le projet d'accord - qui pourrait encore être retouché - va dans le bon sens. De leur côté, les groupes armés présentent à leur base le document à Kidal. "Nous allons travailler de façon transparente, c’est pour cela qu’une commission a été mise en place pour examiner le projet. Nous voulons un accord de paix définitif", dit Ambeiry Ag Rhissa, membre de la délégation des groupes armés maliens à Alger.
Faut-il être optimiste ? Une chose est sûre : après chaque réunion, dans les couloirs de l’hôtel algérois où résident les délégués des deux parties, l’ambiance est plutôt bon enfant. Ce qui fait dire à Ousmane Sy, ministre de la Décentralisation et membre de la délégation gouvernementale : "La nation malienne est intacte, ce qui est difficile entre nous aujourd’hui, c’est de savoir comment on gère cette nation". Rendez-vous est donc pris, si tout se passe bien, à la mi-janvier 2015 pour faire les derniers réglages avant d'aboutir à la signature d’un accord de paix dont nous vous exposons ici les grandes lignes du projet.
1) Quelles institutions pour le nord du Mali ?
Selon le projet d’accord, "la région sera dotée d’une assemblée régionale élue au suffrage universel direct et présidée par une personne, elle-même élue au suffrage universel direct. "Ainsi, le gouverneur de la région jusque là nommé par Bamako disparaît. Il est remplacé par "le président de l’assemblée (qui) est le chef de l’exécutif et de l’administration de la région".
Mais l'État central n'abandonne pas complètement le terrain. Il "nomme auprès des collectivités territoriales des représentants chargés notamment de relayer la politique économique et sociale et d’aménagement du territoire du gouvernement, y compris la négociation des conventions-programme État-Région", et qui seront chargés d'exercer un "contrôle de légalité a posteriori sur certains actes administratifs des collectivités territoriales (…)".
Le texte prévoit aussi "la création d'instances dédiées à la promotion du développement économique et social", une "augmentation du nombre des sièges dans les organes délibérants", ainsi qu'un redécoupage administratif - plutôt flou - des différentes collectivités territoriales, "par voie législative, et ce, conformément aux aspirations et besoins spécifiques des populations concernées (…)." Enfin, l’accord propose la création d’une "zone de développement des régions du Nord" avec "un conseil consultatif interrégional constitué des représentants des assemblées régionales concernées".
2) Quel nom pour les régions du nord du Mali ?
"Azawad" : l'appellation du nord du Mali par les groupes armés a toujours été rejetée par Bamako. Pour contourner - ou reporter - cette difficulté, le projet d’accord suggère que l'on devra reconnaître "aux régions le droit d’adopter, individuellement ou collectivement, la domination officielle de leur choix".
3) Quels financements ?
L'Etat rétrocèdera d'ici à 2018 aux collectivités territoriales "30% de ses recettes budgétaires" comme prévu par la conférence de Bruxelles, mais le pourcentage de rétrocession des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles, notamment minières, reste à définir "d'un commun accord". Par ailleurs l'État s'engage à organiser une Conférence d'appel de fonds pour le financement de la Stratégie de développement des régions du nord du Mali.
4) Quelles forces de sécurité ?
Pour les villes, le document stipule la "création d’une force de sécurité intérieure (police communale ou municipale) qui sera placée sous l’autorité des collectivités locales, dans le cadre de leur pouvoir de police". Pour le reste, l'État gardera la main sur les forces traditionnelles : Garde nationale, gendarmerie, police, dont les éléments se redéployeront "de manière progressive et sur une période d'une année à partir de la signature de l'accord".
5) Quelles garanties pour l'application de l'accord ?
C'est un autre point important dont toutes parties se félicitent : sous l’égide du chef de file, la médiation est le garant politique de l’Accord et du respect de ses dispositions par les parties".
________
Par Baba Ahmed, à Bamako
___
Article pr�c�dent :
Terrorisme en Égypte : après la Grande-Bretagne, le Canada ferme son ambassade au public
Terrorisme en Égypte : après la Grande-Bretagne, le Canada ferme son ambassade au public
0 RÉACTION(S)
MALI
- 08/12/2014 - 14h58
Algérie: un ex-détenu de Guantanamo acquitté dans un procès pour terrorisme - 08/12/2014 - 14h37
Libye: l'ONU tente de pousser les parties en conflit au dialogue - 08/12/2014 - 14h04
L'Algérie va reconduire des milliers de Nigériens - 08/12/2014 - 13h50
Ouganda: une domestique jugée coupable de torture sur un bébé - 08/12/2014 - 13h40
Egypte: les ambassades du Canada et de Royaume-Uni fermées au public
- 1 - Continental Infographie : 10 choses à savoir sur la corruption en Afrique
- 2 - Burkina Faso Burkina Faso : bientôt le retour d'Étienne Zongo, ancien aide de camp de Sankara ?
- 3 - International Le président qui dira oui à l'État palestinien !
- 4 - Continental OIF : la trahison de Dakar
- 5 - International OIF : les couacs du sommet de Dakar, une ombre sur la diplomatie africaine de la France
- Directeur du Département des services du protocole et des conférences (SGPC)Côte d'Ivoire - BAD
- Maîtrise d'oeuvre pour le projet de modernisation du terminal mixte fruitier au port de DoualaCameroun - Association Bananiere du Cameroun
- Un(e) directeur(trice) auprès du bureau régional pour l’asie et le pacifiqueInternational - OIF
- Un(e) directeur(trice) de l’institut de la francophonie pour le développement durableInternational - OIF






















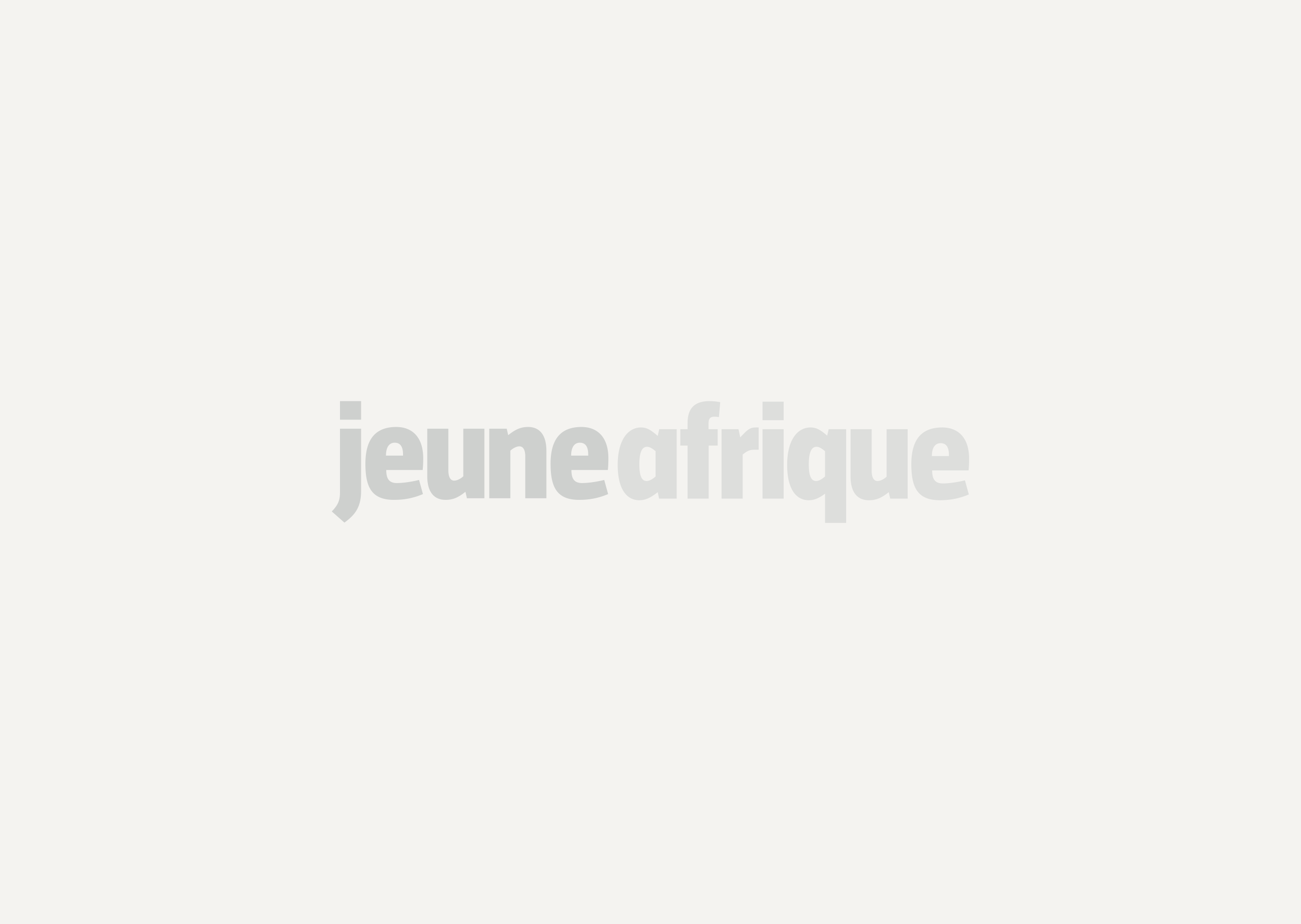

 Un détenu dans la base américaine de Guantanamo le 8 avril 2014
Un détenu dans la base américaine de Guantanamo le 8 avril 2014