Corruption, dictature et sécurité internationale
Spécialiste des questions stratégiques internationales. Pierre Conesa est un praticien des relations internationales et stratégiques qu’il a pratiqué pendant une vingtaine d’années au ministère de la Défense dans différents services (autres qu’administratifs). Auteur de La fabrication de l’ennemi : ou comment tuer avec sa conscience pour soi, éd. R. Laffont, 2011.
La corruption dictatoriale devrait être traitée comme une question de sécurité internationale et non comme une question économique ou simplement éthique, propose P. Conesa. Les pays le plus exposés à la corruption sont ceux qui sont le plus proche de l’écroulement : Afghanistan, Pakistan… Or la sécurité de demain n’est plus la tenue de l’ensemble de la planète par des régimes autoritaires alliés, mais plutôt l’apparition de « zones sans Etat » où s’installent foyers terroristes, crime organisé, trafics d’êtres humains et trafic de drogues. Le sujet devrait donc entrer dans l’agenda de l’OTAN ou de l’Europe de la défense.
Dans le cadre de ses synergies géopolitiques, le Diploweb.com est heureux de vous présenter cet inédit de P. Conesa en amont de sa participation au colloque OGC &Sherpa, « Peut-on récupérer l’argent des dictateurs ? », le vendredi 31 janvier 2014 à Paris.
QUI n’a pas été frappé par la profonde décomposition de l’Etat zaïrois après les 32 ans de dictature de Mobutu dont la fortune (5 milliards $) équivalait à peu près au PIB de son pays lors de son décès ? Que reste-t-il de l’Etat irakien après les 23 ans de dictature de Saddam Hussein, dont la fortune était estimée à 40 milliards $ ? Que dire de la Libye après 41 ans de Kadhafi ? Il ne reste pratiquement rien. On pourrait dresser le même constat avec des cas plus récents comme le Mali qui occupe la 116e place sur 178 pays classés, dans le classement 2010 de Transparency International, en recul de 5 places. Les Touareg n’ont jamais reçu les aides internationales versées lors des grandes sécheresses des années 1995, on comprend mieux la permanence de leur révolte. La RCA saignée pendant 12 ans par l’Empereur Bokassa puis ses successeurs, est aujourd’hui 144e. Les deux Etats pillés sont dans une profonde décomposition qu’on ne peut espérer restaurer par une simple intervention militaire.
Le lien entre corruption publique et instabilité politique est un constat peu discutable.La corruption n’est pas qu’une simple question éthique, ni économique, c’est unequestion de sécurité. Les dictateurs sont soutenus par des puissances tutélaires parce qu’ils assurent la stabilité et la sécurité (des investissements), mais leur chute crée une onde de choc profonde qui va au-delà du simple changement de pouvoir. C’est un calcul stratégique à courte vue qui fait naitre des Etats faillis en divers endroits de la planète.
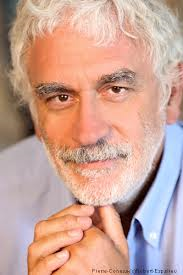 Pierre Conesa. Droits réservés
Pierre Conesa. Droits réservés1. Le pillage dictatorial : un phénomène économique de dimension mondiale
Les dictateurs par la durée de leur maintien au pouvoir et grâce aux méthodes mises en place pour accaparer les ressources en y associant famille, proches, hommes de paille nationaux ou étrangers et surtout les forces de sécurité qui assurent leur maintien au pouvoir, ont systématisé le pillage de leur pays et ainsi déconsidéré tout prélèvement et usage de l’argent public. La corruption dictatoriale est la traduction politique de la mondialisation qui enrichit les plus riches et appauvrit les plus pauvres.
Un dictateur est une forme politique moderne qui sépare fictivement, l’Etat et le régime, le budget public et l’argent privé. Avant cette « modernité », tyran, monarque ou chef de guerre accaparait sans plus de distinction le butin, les biens, les terres, comme le fit Napoléon par exemple dans le temps ou les Emirs des pays du Golfe aujourd’hui… La notion d’argent public n’existe pas, c’est ce qui les différencie des dictateurs. La corruption n’est pas le propre des dictatures. Le pillage « démocratique » atteint aussi de beaux sommets. Madame Ioulia Timochenko, égérie de la démocratisation de l’Ukraine, était classée 3e femme la plus puissante (riche) du monde par le magazine Forbes en 2005 après 10 ans seulement de direction dans les pétroles. La fortune des oligarques russes n’est pas mal non plus. M. Khodorkovski détenait 37 milliards $ à 32 ans. Mais la prison est parfois la sanction !
La question de la restitution de l’argent volé par les chefs d’état a longtemps été taboue.
Un dictateur moderne est un élément d’une géopolitique mondiale. Il tient la solidité et la stabilité de son régime d’un ou plusieurs pays protecteurs. La Guerre froide avait installé la distinction connue entre les dictateurs, « défenseurs du Monde Libre », et les dictateurs « Progressistes », en d’autres termes proches du monde communiste. Les premiers jouissaient de tous les avantages des mécanismes de marché : grands contrats, placements et prises de participation dans les économies riches, cécité garantie sur la prédation, politique d’image et soutien politique en termes de communication sur leurs projets modernistes, accumulation de richesse sans limite… Dans le Top 3 des fortunes des kleptocrates dressée par TI, l’Indonésien Suharto arrivait en première place (31 ans de pouvoir entre 15 et 35 milliards $), le Philippin Ferdinand Marcos (18 ans de pouvoir, 5 à 10 milliards $), le Congolais Mobutu Sese Seko (32 ans de pouvoir, 5 milliards $ seulement [1]). H. Moubarak au pouvoir pendant plus de 35 ans, aurait accumulé entre 40 à 70 milliards $, soit de trois à six années de revenus touristiques de l’Égypte. Le rythme s’est accéléré et amplifié et le Nigérian Sani Abacha après 5 ans de pouvoir seulement, en était de 2 à 5 milliards $.
Les dictateurs protégés des pays communistes plus bridés, épuisaient leur pays et participaient peu à l’économie mondiale (E. Hodja en Albanie, N. Ceausescu en Roumanie et aujourd’hui les Kim en Corée du Nord ou A. Loukachenko en Belarus). Mais l’ouverture économique chinoise crée un modèle nouveau de « dictature socialiste de marché », la prédation communiste [2] s’ancre dans l’économie de marché, les avantages et les protections accordés par le régime élargissent le champ de ses soutiens bien au-delà des adhérents du parti communiste. A l’échelle du pays, faut-il s’étonner que plus de 22 000 citoyens de Chine ou de Hong Kong soient liés à des compagnies et fondations aux Iles vierges ?
Un dictateur moderne est un individu qui profite pleinement de la mondialisation. La liste des États ayant accueilli des avoirs de la famille tunisienne Ben Ali-Trabelsi s’allonge et donne une petite idée des mécanismes de sauvegarde du butin : France, Suisse, Italie, Canada, Qatar, Émirats arabes unis. Difficile cependant d’en faire l’inventaire exhaustif pour l’heure de ce que plusieurs pays recèlent qui n’ont aucune convention de coopération judiciaire ou d’extradition (Argentine, Chypre, Malte).
2. La prédation dictatoriale : la « patrimonialisation » organisée du pays
Le vol associe d’abord la famille consanguine. La famille Suharto possédait un ranch en Nouvelle Zélande d’une valeur de 4 millions $, un luxueux yacht de la même valeur ; le fils Tommy 75% de parts d’un terrain de golf et de 22 appartements à Ascot (Angleterre), plus le projet de développement d’une automobile nationale ; Banbang, le deuxième fils, un appartement luxueux à Singapour (8 millions $) et une maison à Los Angeles (12 millions $), à côté de la maison du troisième fils, Sigit (9 millions $). Tutut, la fille, prit la direction d’un vaste cartel allant des télécommunications à l’hôtellerie de luxe. Les enfants profitèrent du rôle que leur père jouait au sein d’organismes tels que l’ASEAN, le Mouvement des non-alignés, l’APEC ou l’Association de défense des pays islamiques, pour pousser leurs affaires en Malaisie, aux Philippines, en Birmanie, en Corée du sud, à Taiwan ou en Chine : construction d’autoroutes, distribution de l’eau, centrales électriques, réseaux de communication, exploitations minières, pétrolières, forestières, transports maritimes et aériens, leurs activités touchent à tous les secteurs rentables…
La famille M. Kadhafi se débrouillait bien également : Sofia, l’épouse, contrôlait avec ses fils une partie des secteurs de l’économie : pétrole, presse et télécommunications. Avec sa fille, elle avait la mainmise sur une grande partie des boutiques de Lybie. Elle était propriétaire de la compagnie aérienne Buraq Air. Elle aurait accaparé jusqu’à 20 tonnes d’or (mais il faut se méfier des mauvaises langues) ! L’ainé, Mohamed dirigeait l’autorité nationale des télécoms et possédait 40% de la société qui distribue Coca-Cola. Hannibal avait une compagnie de transport maritime. Saadi détenait 7,5% du capital de la Juventus en Italie et une société de production de cinéma. Aicha dirigeait une fondation caritative, mais avait des intérêts dans une clinique privée. Saif Al-Islam, un temps présenté comme Prince consort, dirigeait le fonds souverain libyen et sa filiale One-Nine Group, présente dans l’énergie et l’immobilier.
Les « proches » sont des « familles » au sens mafieux du terme.
Au Pakistan, « Monsieur Benazir Bhutto » de son nom, Asif Ali Zardari s’occupait des affaires pendant que madame gouvernait. Benazir n’accepta de rentrer au Pakistan pour participer au processus de « démocratisation » que si les poursuites contre son mari étaient abandonnées. Ah, l’amour !
Les « proches » sont des « familles » au sens mafieux du terme. La notion de proche varie selon les cultures politiques, ce peut être la famille par alliance (ex la famille Trabelsi-Ben Ali), ce peut être une assise villageoise (les Takritis en Irak), la tribu (Hissène Habre et les Toubous), ou une minorité religieuse (les Alaouites en Syrie). LeJournal officiel de l’UE daté du 5 février 2012 publie la liste des 48 personnalités proches de Ben Ali dont les biens doivent être gelés par décision du Conseil. Mais l’inventaire est difficile à dresser. Les Ben Ali-Trabelsi disposeraient de plusieurs centaines de millions d’euros sur des comptes bancaires en Suisse, à Dubaï et à Malte, ainsi que des avoirs dans plusieurs banques françaises. Le clan possèderait également des appartements à Paris, des propriétés en Ile-de-France, un chalet à Courchevel et des villas sur la Côte d’Azur. Les proches constituent aussi l’interface avec le monde économique international.
Des hommes d’affaires nationaux ou étrangers servent d’hommes de paille, de prête-noms en liant leur avenir à celui du régime. Saddam Hussein avait nommé auprès des organisations onusiennes son demi-frère Barzam Al Takriti, qui gérait les comptes en Suisse avec l’aide de l’homme d’affaires Khalaf Al Doulaimi. Monsieur Habibie était le « monsieur 10% » du régime Suharto. Mais si l’un ou l’autre oublie sa véritable place, la sanction tombe : Rafik Khalifa, fils d’un ancien ministre et trentenaire milliardaire, eut le tort d’escroquer des grands du régime algérien.
Des hauts responsables des puissances tutélaires garantissent la survie du régime dictatorial. En Irak, le journal irakien Al Mada a publié en janvier 2004 une liste de 270 personnes dont 21 Français, des fonctionnaires des Nations Unies qui avaient reçu des « coupons » durant l’opération « Pétrole contre nourriture ».
Et surtout les forces de sécurité (services de renseignement, armée, police….) sans lesquels la dictature ne survivrait pas. Personne n’a dépassé les 100 militaires qui siégeaient au Parlement indonésien sous Suharto. Le régime irakien avait plusieurs milices et autres services de sécurité cloisonnés entre eux et contrôlés par les membres du clan : les al-Mourafikin (l’unité des compagnons) composés de quelques dizaines d’hommes, fournissaient à Saddam ses gardes du corps ; l’Amn el-Khass, la « sécurité privée » dirigée par le fils préféré Qoussaï comptait 8 000 à 10 000 hommes, chargés de la dissimulation des armes chimiques et bactériologiques ; les 30 000 à 40 000 hommes des « Fedayin de Saddam », unité organisée par le fils aîné Oudaï, cagoulée de blanc ou de noir selon les saisons, et chargée notamment de la répression ; les terribles Moukhabarat, de la police secrète, omniprésente, et enfin la Garde républicaine spéciale (20 000 hommes) et la Garde républicaine. Tout cela fait du monde à nourrir ! Les forces de sécurité se greffent alors directement sur l’économie du pays selon que c’est un pays rentier comme en Algérie avec ses inoxydables Généraux ou au Chili où l’armée tire une partie directe de ses ressources du cuivre ; d’autres profitent d’un embargo imposé au pays avec par exemple des Pasdaran en Iran qui contrôlent le trafic frontalier.
3. Une dictature qui tombe, c’est un Etat qui s’écroule !
La perte de valeur stratégique de certaines dictatures explique la chute de certains régimes devenus indéfendables et inutiles surtout s’ils sont renversés par une révolution populaire : Duvallier, Ben Ali, Mobutu, Kadhafi, Gbagbo, Ali Saleh au Yémen… Noriega le dictateur panaméen et agent de la CIA, décoré de la Légion d’Honneur par François Mitterrand, régna de 1969 à 1989, mais ses activités notoires de trafiquant de drogue, lui valurent un débarquement militaire américain.
La crise est financière d’abord ! Le plus souvent le dictateur est renversé au paroxysme d’une grave crise économique et il laisse derrière lui un endettement public énorme. Les nouveaux régimes ont donc de bonnes raisons de ne pas vouloir rembourser la « dette injuste », c’est à dire la part des crédits accordés par des organismes financiers privés ou publics, peu regardants sur le montant de la prédation et de la corruption du régime (pourtant souvent assez bien connues). En Indonésie, de 1966 à 1996, la Banque mondiale a prêté 30 milliards $ dont 10 au moins ont été détournés. Même constat pour la Tunisie de Ben Ali ou l’Egypte de Moubarak. Le FMI dans la décennie 1970-1980 pressaient les pays endettés afin qu’ils s’engagent dans des programmes de privatisation qui se sont transformés en gigantesques hold-up, grâce aux crédits octroyés à la famille régnante (Tunisie, Egypte, Russie sous B. Eltsine…).
La crise est financière d’abord ! Le plus souvent le dictateur est renversé au paroxysme d’une grave crise économique et il laisse derrière lui un endettement public énorme. Les nouveaux régimes ont donc de bonnes raisons de ne pas vouloir rembourser la « dette injuste », c’est à dire la part des crédits accordés par des organismes financiers privés ou publics, peu regardants sur le montant de la prédation et de la corruption du régime (pourtant souvent assez bien connues). En Indonésie, de 1966 à 1996, la Banque mondiale a prêté 30 milliards $ dont 10 au moins ont été détournés. Même constat pour la Tunisie de Ben Ali ou l’Egypte de Moubarak. Le FMI dans la décennie 1970-1980 pressaient les pays endettés afin qu’ils s’engagent dans des programmes de privatisation qui se sont transformés en gigantesques hold-up, grâce aux crédits octroyés à la famille régnante (Tunisie, Egypte, Russie sous B. Eltsine…).
La crise économique est le résultat de la crise qu’on pourrait appeler « managériale », résultat de la « patrimonialisation » du pays. Quelques jours après la fuite de Zine El Abidine Ben Ali, le 14 janvier 2011, ses comptes et ses avoirs ont commencé à être examinés : actifs bancaires, télécommunications, palais et demeures… la fortune du chef d’Etat déchu est incalculable, Banques privées, compagnies aériennes comme Karthago Airlines ou Nouvel Air, une société de production audiovisuelle Cactus, des hôtels 5 étoiles en Tunisie, des actifs immobiliers en Argentine ou au Brésil. Les hommes d’affaires, véreux ou pas, étaient contraints de pactiser avec le pouvoir. La réaction de prudence exige de se mettre à l’abri jusqu’à ce qu’un minimum de stabilité juridique s’instaure et les sociétés étrangères qui ont versé des commissions pour accéder au marché, sont dorénavant exposées à des poursuites en vertu de la convention OCDE contre la corruption des fonctionnaires étrangers. La crise sociale atteint alors son paroxysme.
Enfin la crise des systèmes de sécurité, armée, police, services de renseignement est à la fois le résultat de la révolution et du tarissement soudain des ressources comme l’a vécu l’Irak après l’invasion et l’insécurité s’installe comme en Lybie par exemple.
Mais le risque économique international existe également : les dictateurs les plus riches sont devenus des acteurs politico-économiques de taille mondiale qui peuvent jouer de toute la palette de leurs outils : M. Kadhafi possédait 10% de Finmeccanica la grande holding Italienne, il aurait eu 1,8 milliards d’euros déposés à la Société générale, Saddam Hussein, le dirigeant laïc et moderniste qui voulait investir dans Matra Hachette, etc.
Qui recycle et donne de la furtivité à l’argent détourné des dictateurs ? Des banquiers d’affaires sûrs de leur impunité.
La chute rend aussi leur fortune accessible aux poursuites, ce qui n’était pas envisageable avant. La question de la restitution de l’argent volé par les chefs d’état a longtemps été taboue : ni le Shah d’Iran, ni le Négus n’ont dû rendre l’argent. La justice était paralysée, aidée en cela par le secret bancaire et l’absence de volonté des démocraties à agir contre leurs protégés. Qui recycle et donne de la furtivité à l’argent détourné ? La crise économique et en particulier la lutte contre la fraude fiscale a soudain mis en lumière le monde des Banksters et des Lawsters. La bourgeoisie mafieuse légale (cabinets internationaux d’avocats d’affaires, grandes banques internationales, sociétés et fondations off-shore…) qui assure la furtivité des placements, le blanchiment de ce qu’il faut bien appeler de « l’argent légalement volé », ne répond pas aux questions des journalistes pourtant les enquêtes ont cité les noms de toutes les grandes banques internationales, qui n’ont pas pu résister aux revenus de la gestion de ce pactole. Les frais de gestion des comptes anonymes sont le plus souvent très élevés, c’est la rançon que doivent payer les usurpateurs pour rester dans l’anonymat total. « Chaque fois qu’un dictateur tombe, c’est une Banque suisse qui ferme ! » disait-on mais c’est en partie faux ! Les paradis fiscaux sont des « trous noirs » plus obscurs que la Suisse, qu’aucun mandat international n’atteint. Le Liechtenstein permet 14 formules de recours contre un mandat international, garantissant ainsi l’immunité totale à l’heureux bénéficiaire d’un compte ou d’une fondation à Vaduz [3].
Enfin l’argent dictatorial participe aussi du crime organisé, directement comme Noriega le panaméen, Ashraf la sœur du Shah d’Iran, ou Moncef, frère de Ben Ali, tous couverts par l’immunité diplomatique bien qu’attrapés en flagrant délit de trafic de drogues. La distinction argent sale, « argent propre Sali » du terrorisme, ou argent pas très propre des « Biens mal acquis », procèdent de la même démarche et des mêmes garanties, des mêmes circuits de blanchiment…
Conclusion
La corruption dictatoriale souvent hors d’atteinte de la justice indigène, devrait être traitée comme une question de sécurité internationale et non comme une question économique ou simplement éthique. Les pays le plus exposés à la corruption sont ceux qui sont le plus proche de l’écroulement : Afghanistan, Pakistan… Or la sécurité de demain n’est plus la tenue de l’ensemble de la planète par des régimes autoritaires alliés, mais plutôt l’apparition de « zones sans Etat » où s’installent foyers terroristes, crime organisé, trafics d’êtres humains et trafic de drogues. Le sujet devrait donc entrer dans l’agenda de l’OTAN ou de l’Europe de la défense. On a quand même le droit de rêver [4] !
Copyright Janvier 2014-Conesa/Diploweb.com,http://www.diploweb.com/Corruption-dictature-et-securite.html
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire